chico a écrit :je voudrais revenir sur les coûts du projets. Tout d'abord, j'ai peur que ce projet ne fasse un appel d'air pour d'autres projets qui viendront alourdir l'addition. En effet, j'ai peur qu'il ne faille remplir les boucles du 8 par d'autres modes lourds.
chico a écrit :Tout ça avec une urbanisation croissante qui viendra totalement boucher les boucles du 8. Dans 10 ans, on se retrouve avec des milliards dépensés, et exactement les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, en pire. Car on rajoutera un certain nombre de couples dont l'un travaillera à Bondy et l'autre à Juvisy, le temps de trajet moyen va considérablement augmenter, et l'étalon sera l'heure et non plus la minute.
chico a écrit :Ensuite cela devrait amener des emplois, en lien avec les projets du grand Paris et autres. D'où seront pris ces emplois ? Est-ce que ce sera une création ex-nihilo ? Même dans cette hypothèse cela drainera des emplois de la province. Je ne sais pas combien de personnes aimeraient bien quitter l'IDF, mais si je ne dis pas de bêtise, ils sont nombreux, rien que dans mon entourage. Mais c'est pour beaucoup impossible, car les emplois sont à Paris. La situation ne va certainement pas s'inverser et cette nouvelle ligne va amplifier encore plus le phénomène. On va créer des emplois pour des gens qui n'en voudront pas à cet endroit mais qui seront quand même obligés de les prendre.
chico a écrit :Enfin en ce qui concerne les considération du coût, notamment en rapport au PIB de l'IDF, je soupçonne que les chiffres ne précisent pas un certain nombre de chose. (...) Dans ces conditions, facile de faire 25% de la richesse nationale. Ce n'est pas un problème, mais du coup ce n'est pas un argument pour justifier du coup faible pour la région, car c'est une richesse qui devrait être comptée au niveau nationale, et les revenus de l'Etat dessus devraient être également répartis de manière nationale.
 Cependant, même rapporté à la production réelle de la Région, l'investissement reste faible. Idem si on le rapporte au nombre d'utilisateurs actuels des TC et au potentiel de desserte : avec 1 km d'Arc Express, on touche parfois davantage qu'une ligne de tramway de 20km en province... Il n'en demeure pas moins que, comme toi, je préférerais que l'Etat finance également, comme avant 2003, les projets pertinents de TCSP sur l'ensemble du territoire.
Cependant, même rapporté à la production réelle de la Région, l'investissement reste faible. Idem si on le rapporte au nombre d'utilisateurs actuels des TC et au potentiel de desserte : avec 1 km d'Arc Express, on touche parfois davantage qu'une ligne de tramway de 20km en province... Il n'en demeure pas moins que, comme toi, je préférerais que l'Etat finance également, comme avant 2003, les projets pertinents de TCSP sur l'ensemble du territoire. 


 Bonjour l'effet tunnel...
Bonjour l'effet tunnel...
Pour gagner en temps et en commodité, il faut que les transports en commun fonctionnent la nuit et il
faut libérer les Franciliens des horaires fixes du RER et des trains de banlieue, comme dans le métro.
Il y aura plus de changements mais ils seront plus faciles et avec un raccourcissement considérable des
temps de trajets.
Les Suisses l’ont réalisé sur leur système de transport à l’échelle du pays tout entier. Pourquoi cela ne
serait-il pas possible à l’échelle du territoire francilien ?
 Si vraiment c'est ce qu'"on" nous prépare, si ça permet de rationaliser un peu certaines lignes, et s'il y a les travaux qui permettent d'avoir les infras nécessaires à un tel plan, alors banco. Mais il faut se rendre à l'évidence : à ce moment-là, 35 Md€ ne suffiront plus.
Si vraiment c'est ce qu'"on" nous prépare, si ça permet de rationaliser un peu certaines lignes, et s'il y a les travaux qui permettent d'avoir les infras nécessaires à un tel plan, alors banco. Mais il faut se rendre à l'évidence : à ce moment-là, 35 Md€ ne suffiront plus.Métropaul a écrit :Cependant, même rapporté à la production réelle de la Région, l'investissement reste faible. Idem si on le rapporte au nombre d'utilisateurs actuels des TC et au potentiel de desserte : avec 1 km d'Arc Express, on touche parfois davantage qu'une ligne de tramway de 20km en province... Il n'en demeure pas moins que, comme toi, je préférerais que l'Etat finance également, comme avant 2003, les projets pertinents de TCSP sur l'ensemble du territoire.
 ) serait déjà bien.
) serait déjà bien.
 Mais même avec une politique volontariste d'aménagement du territoire, il restera toujours du monde en IdF. Et dans les transports aussi.
Mais même avec une politique volontariste d'aménagement du territoire, il restera toujours du monde en IdF. Et dans les transports aussi. Ce que j'écris est pour relever le fait que l'argument du PIB est utilisé sans aucun recul par certains pour justifier une dépense pour l'IDF sans se soucier de la province. Pour cela je suis rentré dans ce jeu pour donner un contrepoids à la province en utilisant les mêmes arguments (tu auras remarqué le smiley). Ce qui me choque, c'est que des plans d'ampleurs comparables, rapportés aux tailles des villes concernées, auraient dû apparaître en même temps. Ne serait-ce que pour le noeud lyonnais, il y a fort à faire avec l'aide de l'état, car il s'agit en plus d'un intérêt national car cela concerne les déplacements à l'échelle nationale.
Ce que j'écris est pour relever le fait que l'argument du PIB est utilisé sans aucun recul par certains pour justifier une dépense pour l'IDF sans se soucier de la province. Pour cela je suis rentré dans ce jeu pour donner un contrepoids à la province en utilisant les mêmes arguments (tu auras remarqué le smiley). Ce qui me choque, c'est que des plans d'ampleurs comparables, rapportés aux tailles des villes concernées, auraient dû apparaître en même temps. Ne serait-ce que pour le noeud lyonnais, il y a fort à faire avec l'aide de l'état, car il s'agit en plus d'un intérêt national car cela concerne les déplacements à l'échelle nationale.

Rémi a écrit :Salut
La réactivation de la grande ceinture est en cours puisqu'en 2014, la tangentielle nord sera mise en service entre Epinay et Le Bourget, la tangentielle ouest l'année suivante entre Poissy / St Germain et St Cyr et en 2017, la tangentielle nord reliera Sartrouville à Noisy le Sec. La même année, la branche Massy - Savigny du RER C sera branchée via une ligne de tram sur Evry, et la SNCF fait la campagne pour opérer de même sur Massy - Valenton - Sucy - Champigny - Noisy.
A coup sûr, la grande ceinture sera bien active avant le grand huit !
A+
Rémi
delgui a écrit :bonjour,
oui j'en suis contient mais ce n'est que maintenant alors que ca fait quelques années que l'on parle de crer une ligne reliant la banlieue.
on va peut être dire que je n'aime pas la SNCf mais ce n'est qu'à lheure d'aujourd'hui ou d'un côté elle va concurencé sur les lignes TGV par AIR FRANCE et les lignes locales par d'autre sociéte.
on serait presque amné a dire qu'elle monte des speudo projets extraordinaires pour nous faire croire qu'elle est encore dans la courses des lignes locales.
Rémi a écrit :.... on s'est au passage aperçu que pour être utile, il ne fallait pas tant réellement rouvrir la grande ceinture que la transformer profondément. Un peu comme si on ajoutait des voies de tram le long de la ligne Lyon - Grenoble jusqu'à Bourgoin.
 http://maps.google.fr/maps/ms?sourceid= ... 5&t=h&z=13). Je pensais ces derniers jours au fait que les 3/4 au moins des gens restaient bloqués par principe sur le mot "tramway". Je me disais qu'il serait peut-être pertinent, à la manière des agglomérations qui ont fait ce choix, de parler de "pré-métro" ou "métro léger" vu que les performances de la bête se rapprochent plus du métro. ça serait peut-être un moyen de capter plus facilement l'attention des interlocuteurs, non ?
http://maps.google.fr/maps/ms?sourceid= ... 5&t=h&z=13). Je pensais ces derniers jours au fait que les 3/4 au moins des gens restaient bloqués par principe sur le mot "tramway". Je me disais qu'il serait peut-être pertinent, à la manière des agglomérations qui ont fait ce choix, de parler de "pré-métro" ou "métro léger" vu que les performances de la bête se rapprochent plus du métro. ça serait peut-être un moyen de capter plus facilement l'attention des interlocuteurs, non ?Nicolas Sarkozy avait validé à la fois le plan de mobilisation des transports du président PS du conseil régional, Jean-Paul Huchon (PS), de plus de 18 milliards d'euros et du secrétaire d'Etat Christian Blanc, d'un côut, selon l'Elysée, de 21 milliards d'euros. (© AFP Pierre Verdy)
PARIS (AFP) - Deux mois après le discours de Nicolas Sarkozy annonçant 35 milliards d'euros d'investissements pour "réinventer" le système de transport en Ile-de-France dans le cadre du Grand Paris, de nombreuses questions se posent toujours sur le financement et le calendrier.
"Je souhaite que les travaux démarrent avant 2012, il faut 10 ans en allant vite pour construire les infrastructures", avait déclaré le chef de l'Etat le 29 avril.
Chargé d'étudier les pistes de financement, le député UMP Gilles Carrez doit remettre un premier rapport d'étape d'ici fin juillet et un rapport final début septembre, afin d'intégrer les premières mesures dans le budget 2010 et élaborer un projet de loi spécifique.
M. Carrez, qui a réuni une première fois un groupe technique avec les services des ministères et de la région, doit réunir d'ici à la fin du mois un groupe de 14 parlementaires de droite et de gauche, dont deux élus de province spécialistes des transports.
Le 29 avril, Nicolas Sarkozy avait expliqué que son objectif était de "créer à l'échelle de la métropole un système de transport aussi performant et commode que celui de Paris intra-muros", pour en finir avec "le véritable enfer" vécu par "des millions de Franciliens".
Il avait alors validé à la fois le plan de mobilisation des transports du président PS du conseil régional, Jean-Paul Huchon (PS), de plus de 18 milliards d'euros et du secrétaire d'Etat Christian Blanc, d'un côut, selon l'Elysée, de 21 milliards d'euros.
Ce "grand huit" ou "double boucle" doit relier une dizaine de pôles économiques censés contribuer à la création d'"un million d'emplois en 20 ans".
Après trois réunions du comité de pilotage Blanc-Huchon, qui doit aboutir à un texte de compromis sur le schéma directeur régional, M. Huchon dit avoir "enfin compris d'où venait le chiffre de 35 milliards d'euros" annoncé par le chef de l'Etat.
"Mais, ajoute-t-il, je ne vois toujours pas, et Gilles Carrez non plus, où trouver cet argent". Vendredi, le conseil régional a adopté, l'UMP s'abstenant, un protocole de financement sur son plan de mobilisation, qui atteint presque aujourd'hui 19 milliards.
La région, les huit départements franciliens et le syndicat des transports d'Ile-de-France doivent apporter 12,4 milliards d'euros.
L'Etat est sollicité à hauteur de 3,15 milliards d'euros et la région table sur 3,4 milliards de ressources nouvelles (fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, "versement transport" des entreprises).
Comment faire? Roger Karoutchi (UMP) estime que la valorisation du foncier (aménagement des zones desservies, valorisation commerciale des gares...) peut permettre d'obtenir "beaucoup, beaucoup d'argent".
Parmi les autres pistes figurent les "partenariats public-privé", le "versement transport", les tarifs, le zonage de tarification, les subventions publiques.
En outre conformément au souhait du Premier ministre François Fillon, l'effort de financement doit être "partagé de manière équitable".
Autre difficulté: par où commencer, notamment pour Arc Express? L'Elysée avait parlé de deux phases, la partie la plus proche de Paris devant être faite en premier.
Et dans quel sens? La région entend prolonger Eole (RER E) à l'ouest (Saint-Lazare vers La Défense) tandis que M. Blanc parle "dans un premier temps" de brancher la ligne ferroviaire de Mantes sur le secteur de Nanterre.
© 2009 AFP







 )
)Le Rail a écrit :J'adore les rames de T7, elles sont très belles.
Et n'oublions pas les Translohr de T5 et T6 ! (si on peut appeler ça des trams...)
Airbus a écrit :...
la nouvelle ligne T7 qui relie Villejuif-Louis Aragon (Métro 7) à Athis-Mons via Orly.
...
Le tram adopte en effet dans la zone de Rungis un parcours particulièrement sinueux, et c'est un festival de lenteur !
Dommage car, au départ de Villejuif, les grandes lignes droites et les accélérations fulgurantes des Citadis font merveille avant que la ligne ne prenne une allure de tortillard.
Le vélo et la marche : les transports d’avenir de l’Île-de-France !
par Julien Demade, le 04/12/2015
Le projet du Grand Paris Express est peu mis en débat dans la campagne pour les élections régionales. Et pourtant, selon Julien Demade, ce projet ne fait que prolonger une politique de transports cinquantenaire qui a conduit aux dysfonctionnements actuels. Il propose, afin de les pallier, de réaménager la voirie au profit des piétons et des cyclistes pour l’adapter ainsi aux pratiques réelles de déplacement des Franciliens.
Au-delà de leur diversité politique, tous les candidats aux régionales en Île-de-France partagent le constat du dysfonctionnement des transports. L’engorgement des modes de transport motorisés (qu’il s’agisse des transports en commun, bondés, ou des routes, embouteillées) en est pour eux le signe. On ajouterait volontiers, au titre des manifestations de ce dysfonctionnement, la pollution, qui ne concerne que les seuls modes motorisés individuels – un tiers des gaz à effet de serre sont, en Île-de-France, émis par le trafic routier (Airparif 2014, p. 31) –, et le gouffre financier que représentent les modes motorisés collectifs et individuels – au moins 32 milliards d’euros annuels (STIF 2005, p. 4). Ces dysfonctionnements résultent d’une politique qui s’inscrit dans une histoire longue, que le projet de Grand Paris Express prolonge pourtant.
Des dysfonctionnements ancrés dans l’histoire des politiques de transports en Île-de-France
Cet échec est le résultat d’une politique des transports dont les grandes lignes remontent aux « Trente Glorieuses ». On s’était alors mis à tout organiser autour de la double création d’un réseau autoroutier (le périphérique et les grandes radiales) et d’un réseau ferroviaire souterrain (le RER). Cette politique a ensuite été poursuivie ne varietur, avec notamment la création des autoroutes en rocade et de nouvelles lignes de métro et de RER. Or, alors que la responsabilité de l’échec reconnu par tous en matière de transports ne peut être imputée qu’aux politiques suivies jusqu’ici, la seule solution proposée par l’ensemble du spectre politique consiste en la poursuite des politiques menées jusque-là [1]. Le maître mot, en la matière, est le Grand Paris Express, soit rien moins que le projet de doublement de la longueur du réseau de métro actuel.
On peut s’étonner, en outre, que l’extension du réseau ferré souterrain soit l’objectif principal de la prochaine mandature, alors que l’on n’est aujourd’hui pas même capable de maintenir en l’état le réseau hérité. Le réseau ferré francilien se caractérise, en effet, par sa vétusté : pour ne prendre qu’un exemple, un quart des appareils de voie ont dépassé leur durée de vie maximale théorique (Cour des comptes et Chambre régionale des comptes d’Île-de-France 2010, p. 90). De cette incapacité, purement financière, à pallier la sénescence croissante d’un réseau hérité, témoigne bien le fait que l’actuel exécutif régional s’était engagé, pour la mandature qui s’achève, à ce que toutes les rames soient rénovées ou remplacées par des neuves, promesse qu’il a été bien incapable de tenir, et que s’empressent pourtant de reprendre à leur compte tous les candidats pour la mandature qui va s’ouvrir. Or, les candidats reconnaissent plus ou moins ouvertement l’incapacité à financer un tel chantier. En matière de politique des transports, la région Île-de-France fait ainsi face, aujourd’hui, à un impératif difficilement gérable : l’entretien du réseau hérité, réseau que l’on avait négligé parce qu’on l’avait considéré comme un acquis et pour lequel il faut désormais dégager rapidement rien moins que 8 milliards d’euros [2]. Croire que l’on pourra, au même moment, s’engager dans une extension jamais vue du réseau ferré francilien – extension dont le coût est chiffré à 32 milliards (Auzannet 2012, p. 17) –, est, pour le dire poliment, utopique – fantasme qui pourtant constitue l’essentiel du programme de la plupart des formations politiques franciliennes [3].
La marche : premier mode de déplacement des Franciliens
La situation des transports franciliens est-elle pleinement décrite par ce double constat déprimant de leur dysfonctionnement et de notre incapacité à y remédier ? Nullement, mais pour le voir il convient, précisément, de rompre avec les politiques reproduites sans réflexion depuis maintenant plus d’un demi-siècle. Pour cela, il n’est de meilleure méthode que de partir des pratiques réelles de déplacement des Franciliens qui donnent du problème une tout autre image que celle véhiculée par le débat politique. En effet, le premier mode de déplacement des Franciliens n’est pas l’un de ces modes motorisés qui seuls intéressent le personnel politique, mais bien la marche, qui représente 39 % de leurs trajets (OMNIL 2012 [4]) – et dont, pourtant, aucun des programmes ne traite. L’essentiel des déplacements des Franciliens se font, en effet, sur des distances qui ne requièrent pas l’emploi de modes motorisés, puisque 45 % de leurs trajets font moins d’un kilomètre – ce qui correspond à peu près à la part modale de la marche. En outre, 30 % des déplacements font entre un kilomètre et cinq kilomètres, ce qui correspond aux distances aisément réalisables à vélo – et ce n’est certes pas un hasard si cela correspond aussi, peu ou prou, à la part modale du vélo dans un pays doté d’une véritable politique cyclable tel que les Pays‑Bas (Fietsberaad 2009, p. 10). On ne saurait alors s’étonner que le vélo soit de tous les modes de déplacement celui qui, et de très loin, croît le plus rapidement : + 115 % en dix ans, une véritable explosion sans commune mesure avec les autres modes (la voiture n’a progressé que d’1 % et les transports en commun de 21 %). Au total donc, 75 % des déplacements franciliens font moins de cinq kilomètres et sont, de ce fait, aisément réalisables par le biais de modes non motorisés – pour autant que ceux-ci ne soient pas exclus de la voirie par l’aménagement strictement automobile de celle-ci qui est actuellement la règle. On voit ainsi que ces modes non motorisés, qui ne sont généralement considérés, au mieux, que comme complémentaires de la voiture et des transports en commun, sont en réalité d’ores et déjà au centre des déplacements franciliens, et pourraient l’être considérablement plus si l’on faisait pour eux à l’avenir une fraction seulement des efforts déployés depuis des décennies en faveur des modes motorisés. Ces derniers devraient être considérés comme n’ayant de pertinence qu’en tant que complémentaires des modes non motorisés, puisque seuls 10 % des déplacements des Franciliens s’effectuent sur des distances supérieures à dix kilomètres, et rendent donc impératif le recours aux modes motorisés.
Il convient donc d’inverser la politique francilienne des déplacements pour l’adapter aux pratiques réelles de déplacement des Franciliens et aux transformations rapides de celles-ci en faveur des modes non motorisés, mais aussi parce que seule une telle adaptation permettra de résoudre les dysfonctionnements actuels. En effet, voiture comme transports en commun, délestés de la majorité de leurs usages actuels [5] qui pourraient être effectués à pied et à vélo, ne seront plus engorgés. Tous les problèmes liés à cet engorgement disparaîtront du même coup. La pollution automobile en sera drastiquement diminuée, de même que le coût des transports en commun, en fonctionnement comme en investissement, puisque nombre des points d’engorgement auront disparu d’eux-mêmes [6].
Une piste à explorer : le développement des itinéraires cyclables Paris–banlieue
Un exemple permet de prendre concrètement conscience des potentialités qui sont à portée de main. Les transports en commun ne sont jamais aussi engorgés que lorsqu’ils assurent avant tout des déplacements domicile–travail, puisque ceux-ci génèrent le phénomène d’« heure de pointe ». Or, les transports en commun, où la proportion des déplacements domicile–travail est la plus élevée, sont ceux qui relient Paris à la banlieue, parce que 75 % des banlieusards qui viennent travailler à Paris s’y rendent en transports en commun. Comme chaque jour 360 000 déplacements entre Paris et la banlieue s’effectuent en transports en commun sur des distances inférieures à cinq kilomètres, le potentiel de désengorgement de ces liaisons par le vélo correspond à l’équivalent, par exemple, d’une ligne du Grand Paris Express (la ligne 15, dont le coût prévu est de cinq milliards d’euros, devrait assurer 300 000 déplacements par jour – quand elle sera terminée, c’est-à-dire pas avant 2030), ou du périphérique (240 000 véhicules par jour). Pour enclencher un tel report, il suffirait d’un aménagement cyclable des voies qui relient Paris à la banlieue, aujourd’hui organisées de façon généralement autoroutière. Cet aménagement est d’un coût faible [7], et aisément réalisable puisque la circulation automobile entre Paris et la banlieue a baissé ces dix dernières années de 25 %, la libérant ainsi pour d’autres usages. Quant à l’effet sur la circulation cycliste de tels aménagements, et donc à la réalité du report vers le vélo, ils ne font aucun doute dans la mesure où les déplacements entre Paris et la banlieue représentent d’ores et déjà le segment de la circulation cycliste qui connaît la croissance la plus rapide : multiplication par quatre en dix ans (Demade 2015, p. 105‑118). Où est, alors, l’utopisme ? Dans le fait de réclamer que l’on se dote enfin d’une vraie politique cyclable, ou dans les irréalisables fantasmes de construction d’un nouveau réseau ferré ? Dans une politique peu coûteuse et immédiatement réalisable, ou dans une politique aussi dispendieuse que son horizon de réalisation est lointain, pour ne pas dire franchement chimérique ?
À quoi ressemblerait une proposition globale de politique francilienne des déplacements qui soit rationnelle, c’est-à-dire adaptée à la réalité ? En premier lieu, il convient d’adapter la voirie aux modes non motorisés qui représentent déjà, avec la marche, le mode d’usage le plus important en matière de transport. Cette part ne cesse de croître, pour ce qui est du vélo, tandis que l’usage automobile de la voirie recule désormais dans l’agglomération parisienne. En second lieu, les moyens financiers, de toute façon insuffisants, doivent être consacrés prioritairement au maintien à flot du réseau de transports en commun existant afin d’éviter que son état ne se dégrade. En troisième lieu, pour résoudre de manière financièrement viable et à un horizon temporel pas trop éloigné le manque réel de transports en commun de banlieue à banlieue que prétendait pallier le Grand Paris Express, il faut poursuivre la création de lignes de tramways et de bus en site propre, entamée depuis les années 1990 avec grand succès et qui ne doit en aucun cas être interrompue au profit de la chimère du Grand Paris Express – rappelons qu’une ligne de tramway coûte à peu près vingt fois moins qu’une ligne de métro. Au total, alors que tant pourrait être fait, et pour un coût finançable, pour améliorer les déplacements réels des Franciliens, il serait regrettable que la mandature qui arrive voie l’ensemble du personnel politique francilien consacrer tous ses efforts à un irréalisable nouveau réseau ferré souterrain. Il est trop tard pour y perdre du temps ; il est au contraire urgent que la politique francilienne des déplacements entre enfin dans le XXIe siècle plutôt que de chercher à proroger un passé qui n’a pourtant apporté qu’un lot de dysfonctionnements toujours plus grands.
Bibliographie
Airparif. 2014. Inventaire régional des émissions en Île-de-France, année de référence 2012 : éléments synthétiques.
Auzannet, P. 2012. Rapport de la mission sur le calendrier pluriannuel de réalisation et de financement du projet de Grand Paris Express, Paris : Ministère de l’Égalité des territoires et du logement.
Cour des comptes et Chambre régionale des comptes d’Île-de-France. 2010. Les Transports ferroviaires régionaux en Île-de-France, rapport public.
Demade, J. 2015. Les Embarras de Paris, ou l’illusion techniciste de la politique parisienne des déplacements, Paris : L’Harmattan.
Fietsberaad. 2009. Le Vélo aux Pays-Bas, La Haye : Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Observatoire de la mobilité en Île-de-France. 2012. La Mobilité en Île-de-France.
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). 2005. Compte déplacements de voyageurs en Île-de-France pour l’année 2003.
Notes
[1] La seule différence entre les candidats porte sur le point de savoir s’il faut poursuivre à la fois les politiques autoroutière et ferroviaire, ou seulement la seconde.
[2] Soit à peu près 13 ans d’efforts, au niveau qui était celui du budget d’investissement en 2014 – on voit que l’on dépasse largement l’horizon de la mandature à venir.
[3] Le grand gagnant en la matière est le PS, dont 12 pages des 20 qui traitent de la question des déplacements dans son programme font l’article du Grand Paris Express.
[4] Idem pour les données suivantes.
[5] Ainsi, par exemple, la moitié des déplacements en voiture font moins de trois kilomètres.
[6] Par comparaison, la réalisation intégrale du Grand Paris Express ne permettrait, pour un coût abyssal, que le report de 2 millions de déplacements motorisés individuels, sur les 16 millions qui se réalisent quotidiennement en Île-de-France – alors que l’on en compte 8 millions de déplacements qui font moins de trois kilomètres et sont donc particulièrement facilement substituables par le vélo.
[7] L’aménagement d’une piste cyclable coûte 130 000 euros du kilomètre, là où le coût prévisionnel du Grand Paris Express est de 130 millions du kilomètre ; quant au dernier tronçon de l’A86, son coût est monté à 240 millions du kilomètre.




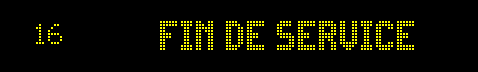
Billy a écrit :Les transports de Paris sont saturés justement car la plupart des modes obligent à y passer, surtout pour les déplacements de banlieue à banlieue : Châtelet les Halles en est le meilleur exemple étant donné que c'est le principal pôle de correspondance des modes lourds.
Je ne suis pas d'accord (pour une fois) avec toi Nanar car il faut justement créer des modes alternatifs pour les déplacements de rocade, afin de désengorger Paris et de réduire le temps de transport.
Cependant là où je te rejoins, c'est qu'il faut conjointement développer les modes doux. Mais il ne faut pas compter que là dessus
Julien Demade, dans le dernier paragraphe, a écrit :En troisième lieu, pour résoudre de manière financièrement viable et à un horizon temporel pas trop éloigné le manque réel de transports en commun de banlieue à banlieue que prétendait pallier le Grand Paris Express, il faut poursuivre la création de lignes de tramways et de bus en site propre, entamée depuis les années 1990 avec grand succès et qui ne doit en aucun cas être interrompue au profit de la chimère du Grand Paris Express
BBArchi a écrit :
http://www.lejournaldelarchitecte.fr/ac ... ouwel.html
... Quant au viaduc en béton, on ressort visiblement les coffrages des usines de préfabrication... elles aussi des années 70.
...
Faut arrêter, maintenant. En 2016, soit plus de 50 ans après, on doit pouvoir imaginer, pour le même prix, des structures avec une autre gueule !...



 )
)

C’est le marché du siècle, qui fait saliver plus d’une entreprise. Le Grand Paris Express, c’est 200 km de lignes nouvelles de métro et 68 gares à construire d’ici 2030, soit un chantier d’au moins… 25 Md€. « Un investissement d’avenir qui portera l’économie du pays », a lancé Philippe Yvin, président de la Société du Grand Paris (SGP), lors de ses vœux la semaine dernière. 2017 marque l’entrée en chantier de quatorze des seize gares de la ligne 15 Sud (Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs), et la mise en route du premier tunnelier. Un chantier gigantesque qui fait rêver PME, poids lourds du BTP, pros des transports et élus.
Qui pour creuser et construire ?
Plus de 4 000 salariés travaillent déjà sur le futur métro (2 500 ingénieurs et architectes, 1 500 ouvriers). Certains étaient à pied d’œuvre cette semaine avec SNCF Réseau pour une première opération majeure (5 M€) : le ripage d’un pont sous des voies de chemins de fer (photo ci-contre), à Champigny (Val-de-Marne). Il y en aura des dizaines d’autres ! Plus d’un milliard d’euros de travaux sont prévus cette année et, au plus fort des chantiers, en 2018, la Fédération régionale des travaux publics table sur 22 000 emplois.
Pour répartir cette masse de travail, la SGP a tronçonné les lignes en différents lots, afin que plusieurs entreprises puissent creuser ou construire les gares en même temps. 2017 sera très importante : les cinq derniers marchés de la 15 Sud et les deux premiers de la 16 seront attribués, soit près de 9 Mds€ ! Bouygues, Vinci et Eiffage, les géants français du secteur, sont dans les starting-blocks.
Mais l’attribution en 2016 d’un premier tunnel de 7 km pour 363 M€ au Français Demathieu Bard, associé à des Italiens, des Belges et des Suisses, a fait grincer quelques dents. « Il ne peut pas y avoir de préférence nationale, c’est interdit », tranche Philippe Yvin. En revanche, la SGP oblige les entreprises à faire travailler 20 % de PME. Un observatoire sera lancé dans les prochains jours pour vérifier que cette disposition est bien appliquée.
Qui pour faire rouler ?
Selon la loi sur le Grand Paris, la RATP, opérateur historique du métro parisien, bénéficie de droit de la gestion des infrastructures (rails et tunnels) du Grand Paris Express. Mais l’exploitant (celui qui fera rouler les métros) sera, lui, désigné à l’issue d’un appel d’offres ouvert à la concurrence. Celui-ci doit être lancé cette année. La RATP sera bien sûr sur les rangs, mais aussi Keolis (filiale de la SNCF), et sans doute d’autres professionnels des transports, français ou étrangers. La bataille sera rude. Keolis a déjà redouté publiquement que la gestion des infrastructures ne donne un avantage à la RATP, et a lancé une opération séduction pour montrer son savoir-faire, à Londres par exemple.
La même compétition devrait avoir lieu pour le matériel roulant : Alstom et ses concurrents seront sans doute sur les rangs pour construire les rames. La SGP va lancer cette année le marché des métros automatiques de la 15 Sud : à la clé, la construction de 120 trains, représentant 516 voitures, d’ici à 2025 ! Le gagnant sera connu en 2018.
Qui pour diriger ?
C’est une autre bataille, en coulisses, qui s’est jouée jusqu’en fin d’année dernière. Celle pour la gouvernance du futur métro. Valérie Pécresse a milité pour une fusion entre le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif), qu’elle préside, et la SGP. Une idée rejetée par Philippe Yvin, et ensuite par le Conseil économique, social et environnemental (Ceser), sollicité pour donner un avis.
Grâce à un lobbying discret et efficace, la SGP conserve son autonomie — et ses milliards… pour l’instant. Car les prochaines échéances électorales vont contribuer à remettre le dossier sur la table. Une autre étape dans la bataille du Grand Paris.

Revenir à « Le forum de Lyon en Lignes »
Utilisateurs parcourant ce forum : NP73, Semrush [Bot] et 45 invités